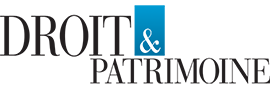Notes
(1)
Règl. PE et Cons. n° 650/2012/UE, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, JOUE 27 juill., n° L 201.
Retour au texte
(5)
Conv. Rome, 19 juin 1980, et Règl. PE et Cons. n° 593/2008/CE, 17 juin 2008, dit règlement « Rome I », sur la loi applicable aux obligations contractuelles, JOUE 4 juill., n° L 177.
Retour au texte
(6)
P. Berlioz, La clause d’exception, in T. Azzi et O. Boskovic (dir.), Quel avenir pour la théorie générale du conflit de lois ?, Larcier, Bruxelles, 2015, p. 189.
Retour au texte
(7)
CJUE, 23 oct. 2014, aff. C-305/13, Haeger & Schmidt, Dr. & patr. 2014, n° 242, p. 82.
Retour au texte
(8)
CJCE, 6 oct. 2009, aff. C-133/08, ICF, Dr. & patr. 2009, n° 187, p. 109.
Retour au texte
(9)
Pour un précédent, émanant de la Chambre commerciale, v. Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-19.723, Dr. & patr. 2007, n° 165, p. 80.
Retour au texte
(10)
Règl. Rome I, consid. 20 : « (…) Afin de déterminer (le) pays (dont la loi prévaudra finalement), il convient de prendre en compte, notamment, l’existence de liens étroits du contrat avec un ou plusieurs autres contrats ».
Retour au texte
(11)
Rappr. CA Versailles, 6 févr. 1991, Rev. crit. DIP 1991, p. 745, note P. Lagarde, JDI 1992, p. 125, note J. Foyer.
Retour au texte
(12)
J. Foyer, note précitée sous CA Versailles, 6 févr. 1991. Rappr. Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-11.751, Dr. & patr. 2011, n° 209, p. 89.
Retour au texte
(13)
En réalité, en tout premier lieu, la Cour de cassation a reproché aux juges d’appel de ne pas avoir déterminé la loi applicable à la charge de la preuve du montant restant dû à la banque (v. Conv. Rome, art. 14.1, qui confie cette question à la loi du contrat, c’est-à-dire, ici, à la loi du cautionnement). En l’espèce, la cour d’appel avait d’abord fait peser la charge de la preuve sur les épaules de la banque, pour ensuite s’inquiéter de la loi applicable au contrat.
Retour au texte
(14)
On retrouve ici la définition canonique posée par P. Francescakis, qui est reprise, avec peu de variations, par l’article 9.1 du règlement « Rome I ».
Retour au texte
(15)
Cass. com., 13 juill. 2010, nos 10-12.154 et 09-13.354, Dr. & patr. 2010, n° 198, p. 114.
Retour au texte
(16)
Cass. 1re civ., 22 oct. 2008, n° 07-15.823, Dr. & patr. 2009, n° 187, p. 109 ; Cass. com., 8 juill. 2010, n° 09-67.013, Dr. & patr. 2010, n° 198, p. 114.
Retour au texte
(17)
Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-19.723, précité ; Cass. com., 27 avr. 2011, n° 09-13.524, Dr. & patr. 2011, n° 209, p. 90.
Retour au texte
(18)
Cass. ch. mixte, 30 nov. 2007, n° 06-14.006, Dr. & patr. 2008, n° 176, p. 93.
Retour au texte
(20)
Cass. 3e civ., 25 févr. 2009, n° 07-20.096, Dr. & patr. 2009, n° 187, p. 109.
Retour au texte
(21)
H. Batiffol, Les conflits de lois en matière de contrats, Sirey, 1938, n° 469 ; Y. Flour, L’effet des contrats à l’égard des tiers en droit international privé, thèse, 1977, n° 83 ; P. Lagarde, La sous-traitance en droit international privé, in C. Gavalda (dir.), La sous-traitance de marchés de travaux et de services, Economica, 1978, p. 186 et s., spécialement p. 197-198.
Retour au texte
(22)
Règl. PE et Cons. n° 864/2007/CE, 11 juill. 2007, JOUE 31 juill., n° L 199.
Retour au texte
(23)
Cass. 1re civ., 20 déc. 2000, nos 98-15.546 et 98-16.103, JCP G 2001, I, chron. 340, n° 33, obs. G. Viney, Rev. crit. DIP 2001, p. 683, note V. Heuzé, RTD com. 2001, p. 1057, obs. P. Delebecque.
Retour au texte
(24)
Sur un « acteur » plus rare en jurisprudence, v. Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 14-10.661, RLDC 2015/131, n° 6014, obs. G. Chabot, à propos de la capacité d’une fondation de droit suisse à recevoir un legs régi par la loi successorale française.
Retour au texte
(25)
Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-22.983, Dr. & patr. 2013, n° 231, p. 82.
Retour au texte
(26)
Cass. civ., 24 juin 1878 et Cass. req., 22 févr. 1882, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, par B. Ancel et Y. Lequette, Dalloz, 2006, nos 7-8.
Retour au texte
(27)
Cass. 1re civ., 11 févr. 2009, n° 06-12.140, Dr. & patr. 2009, n° 187, p. 104.
Retour au texte
(28)
Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-159 QPC, Dr. & patr. 2011, n° 209, p. 93.
Retour au texte
(29)
TGI Paris, 10 juill. 2013, RG n° 06/13502, Dr. & patr. 2013, n° 231, p. 82.
Retour au texte
(30)
En amont, les enfants contestaient aussi l’application immédiate de la décision du Conseil constitutionnel à la succession de leur père, ouverte avant le 5 août 2011. Mais le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l’abrogation devait produire ses effets dans la présente affaire.
Retour au texte
(31)
Cass. 1re civ., 20 mars 1985, Rev. crit. DIP 1986, p. 66, note Y. Lequette. Comp. Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-15.425, Dr. & patr. 2005, n° 142, p. 112.
Retour au texte